
Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
Hémorragie: symptômes, arrêt du saignement
Expert médical de l'article
Dernière revue: 07.07.2025
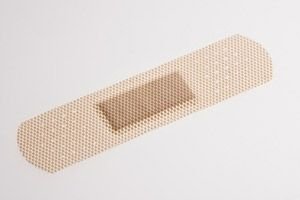
Un saignement est une fuite de sang d'un vaisseau vers l'environnement, les tissus ou une cavité corporelle. La présence de sang dans une cavité particulière porte un nom. Ainsi, l'accumulation de sang dans la cavité thoracique est appelée hémothorax, dans la cavité abdominale, hémopéritoine, dans le péricarde, hémarthrose dans une articulation, etc. La cause la plus fréquente de saignement est un traumatisme.
L'hémorragie est une saturation diffuse de tout tissu par du sang (par exemple, le tissu sous-cutané, le tissu cérébral).
Un hématome est une accumulation de sang confinée aux tissus.
Symptômes hémorragies
Les symptômes d'un saignement dépendent de l'organe endommagé, du calibre du vaisseau blessé et de la direction du flux sanguin. Tous les signes de saignement sont classés en symptômes généraux et locaux.
Les symptômes généraux des hémorragies externes et internes sont les mêmes: faiblesse, vertiges avec évanouissements fréquents, soif, pâleur de la peau et (surtout) des muqueuses (lèvres blanches), pouls faible et fréquent, tension artérielle progressivement en baisse et instable, diminution brutale du nombre de globules rouges et du taux d'hémoglobine.
Les symptômes locaux d'hémorragie externe ont déjà été répertoriés; les principaux sont les saignements provenant d'une plaie. Les symptômes locaux d'hémorragie interne sont extrêmement variés et leur apparition dépend de la cavité dans laquelle le sang s'écoule.
- Ainsi, en cas de saignement dans la cavité crânienne, le tableau clinique principal consiste en des symptômes de compression du cerveau.
- Lorsqu'un saignement se produit dans la cavité pleurale, des signes d'hémothorax apparaissent avec toute une série de signes physiques (essoufflement, raccourcissement du son de percussion, affaiblissement de la respiration et du frémissement vocal, limitation des excursions respiratoires) et des données provenant de méthodes de recherche auxiliaires (radiographie thoracique, ponction de la cavité pleurale).
- L'accumulation de sang dans la cavité abdominale entraîne des symptômes de péritonite (douleurs, nausées, vomissements, tension des muscles de la paroi abdominale antérieure, symptômes d'irritation péritonéale) et une sensation de matité dans les parties inclinées de l'abdomen. La présence de liquide libre dans la cavité abdominale est confirmée par échographie, ponction ou laparocentèse.
- En raison du petit volume de la cavité, le saignement dans l'articulation n'est pas massif, de sorte qu'une anémie aiguë, qui menace la vie du patient, ne se produit jamais, comme dans le cas d'autres saignements intracavitaires.
- Le tableau clinique d'un hématome intra-tissulaire dépend de sa taille, de sa localisation, du calibre du vaisseau endommagé et de la présence d'une communication entre celui-ci et l'hématome. Les manifestations locales incluent un gonflement important, une augmentation du volume du membre, une compaction tissulaire et un syndrome douloureux.
Un hématome à croissance progressive peut entraîner une gangrène du membre. En l'absence de gangrène, le membre présente une légère diminution de volume, mais une détérioration du trophisme de la partie distale est clairement observée. À l'examen, une pulsation est détectée au-dessus de l'hématome, ainsi qu'un souffle systolique, indiquant la formation d'un faux anévrisme.
Qu'est ce qui te tracasse?
Formes
Il n'existe pas de classification internationale unique des saignements. Une classification « de travail » a été adoptée, reflétant les aspects les plus importants de ce problème complexe, nécessaires à la pratique. Cette classification a été proposée pour la pratique clinique par l'académicien B.V. Petrovsky. Elle comprend plusieurs positions principales.
- Selon le principe anatomique et physiologique, les saignements sont divisés en artériels, veineux, capillaires et parenchymateux; ils ont des caractéristiques dans le tableau clinique et les méthodes d'arrêt.
- En cas de saignement artériel, le sang est de couleur écarlate, s'écoule en un flux pulsé, ne s'arrête pas de lui-même, ce qui conduit rapidement à une anémie aiguë sévère.
- Lors d'un saignement veineux, le sang est de couleur foncée et s'écoule plus lentement à mesure que le calibre du vaisseau est plus petit.
- Les saignements parenchymateux et capillaires sont extérieurement identiques, leur différence avec les précédents est l'absence de source visible de saignement, la durée et la complexité de l'hémostase.
- En fonction des manifestations cliniques, les saignements sont divisés en externes et internes (cavité, cachés).
- En cas d’hémorragie externe, le sang s’écoule dans l’environnement extérieur.
- Lors d'une hémorragie interne, le sang pénètre dans une cavité corporelle ou un organe creux. Les saignements cachés dus à des blessures sont presque toujours rares. Ils sont souvent causés par des ulcères gastriques ou intestinaux.
- Selon le moment de l'apparition du saignement, on distingue les saignements primaires, secondaires précoces et secondaires tardifs.
- Les premiers symptômes commencent immédiatement après la blessure.
- Les saignements secondaires précoces surviennent dans les premières heures et les premiers jours suivant la blessure, suite à l'expulsion du thrombus hors du vaisseau lésé. Ces saignements sont dus à une violation des principes d'immobilisation, à une activation précoce du patient et à une hypertension artérielle.
- Des saignements secondaires tardifs peuvent survenir à tout moment après la suppuration de la plaie. Leur apparition est due à la fusion purulente d'un thrombus ou de la paroi vasculaire par un processus inflammatoire.
Saignement artériel
Se produit lorsqu'une artère est lésée: du sang rouge écarlate et vif jaillit de la plaie en un jet, tel une fontaine. L'intensité de la perte sanguine dépend de la taille du vaisseau endommagé et de la nature de la blessure. Des saignements importants surviennent en cas de plaies latérales et pénétrantes des vaisseaux artériels. En cas de ruptures vasculaires transversales, on observe souvent un arrêt spontané du saignement dû à la contraction des parois vasculaires, à l'inversion de l'intima déchirée dans sa lumière, suivie de la formation d'un thrombus. L'hémorragie artérielle est potentiellement mortelle, car une grande quantité de sang est perdue en peu de temps.
 [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
Saignement veineux
Lors d'une hémorragie veineuse, le sang non oxygéné qui s'écoule est foncé, ne pulse pas, s'écoule lentement dans la plaie et saigne davantage à l'extrémité périphérique du vaisseau. Les lésions des grosses veines proches du cœur sont dangereuses, non seulement en raison du saignement abondant, mais aussi du risque d'embolie gazeuse: l'air pénètre dans la lumière d'un vaisseau sanguin pendant la respiration, ce qui perturbe la circulation pulmonaire, entraînant souvent le décès du patient. Les hémorragies veineuses des vaisseaux de moyen et petit calibre sont moins mortelles que les hémorragies artérielles. Un débit sanguin lent provenant des vaisseaux veineux et des parois vasculaires qui s'affaissent facilement sous l'effet de la compression contribuent à la formation d'un thrombus.
En raison des particularités du système vasculaire (les artères et les veines du même nom étant situées à proximité les unes des autres), les lésions isolées des artères et des veines sont rares; la plupart des saignements sont donc de type mixte (artério-veineux). Ce type de saignement survient lorsqu'une artère et une veine sont lésées simultanément et se caractérise par une combinaison des signes décrits ci-dessus.
Saignement capillaire
Se produit lorsque les muqueuses et les muscles sont endommagés. En cas de saignement capillaire, toute la surface de la plaie saigne, le sang « suinte » des capillaires endommagés. Le saignement s'arrête lorsqu'un pansement simple ou légèrement compressif est appliqué.
Les lésions du foie, des reins et de la rate s'accompagnent d'hémorragies parenchymateuses. Les vaisseaux des organes parenchymateux sont étroitement fusionnés au tissu conjonctif de l'organe, ce qui prévient leur spasme; l'arrêt spontané du saignement est difficile.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Hémorragie externe
Il s’agit d’un écoulement de sang à la surface du corps provenant de plaies, d’ulcères (généralement dus à des varices) et, plus rarement, de tumeurs cutanées.
Selon le type de vaisseau hémorragique, on distingue: artériel (le sang est écarlate, jaillit et, si un gros vaisseau est blessé, il pulse); veineux (le sang est foncé, coule lentement, mais peut être intense si de grosses veines sont blessées); capillaire (transpiration sous forme de gouttes individuelles qui fusionnent; en cas de lésions cutanées importantes, elles peuvent provoquer une perte de sang massive). En termes de durée, la plupart des saignements sont primaires. Les saignements secondaires se développent rarement, principalement érosifs à partir d'ulcères.
Le diagnostic d'une hémorragie externe est simple. La tactique consiste à mettre en place sur les lieux de l'incident les méthodes d'arrêt temporaire du saignement, puis à transporter le patient vers un hôpital chirurgical pour l'arrêt définitif du saignement et la correction de la perte sanguine.
 [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]
[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]
Saignement intratissulaire
Elles se développent suite à des traumatismes (ecchymoses, fractures), à des maladies accompagnées d'une augmentation de la perméabilité vasculaire ou à des troubles de la coagulation sanguine (hémophilie, syndrome d'Aureka en cas d'insuffisance hépatique et hypovitaminose K), à des ruptures vasculaires et à des dissections anévrismales. Elles peuvent se former superficiellement, localisées dans la peau, le tissu sous-cutané et les espaces intermusculaires, ou intra-organiques (principalement dans les organes parenchymateux) suite à des traumatismes (ecchymoses) et à des ruptures anévrismales. Elles sont divisées en deux types.
- En cas de saturation uniforme des tissus par les érythrocytes (imbibition), le processus est appelé hémorragie. Les hémorragies superficielles ne posent pas de difficultés diagnostiques, car elles sont visibles à l'œil nu sous forme d'ecchymose, qui disparaît spontanément avec une atténuation progressive: les deux premiers jours, elles sont de teinte violet-violet; jusqu'au 5-6e jour, elles sont bleues; jusqu'au 9-10e jour, elles sont vertes; jusqu'au 14e jour, elles sont jaunes.
- Une accumulation libre de sang liquide - dans le tissu sous-cutané, les espaces intermusculaires, dans les tissus lâches, par exemple dans l'espace rétropéritonéal; tissus des organes parenchymateux - est appelée hématome.
Les hématomes superficiels avec accumulation de sang dans le tissu sous-cutané et les espaces intermusculaires se forment suite à un traumatisme (ecchymoses, fractures, etc.) ou, plus rarement, à une rupture d'anévrisme vasculaire. Cliniquement, ils s'accompagnent d'une augmentation du volume du segment, souvent en saillie au-dessus de l'ecchymose. La palpation révèle une formation élastique, molle, modérément douloureuse, le plus souvent accompagnée d'un symptôme de fluctuation (sensation de liquide roulant sous la main). En cas de rupture d'anévrisme, une pulsation de l'hématome est également déterminée, parfois visible à l'œil nu; un souffle systolique est audible à l'auscultation. Le diagnostic est généralement simple, mais en cas de doute, il peut être confirmé par angiographie.
Les hématomes peuvent devenir purulents, donnant l’image typique d’un abcès.
Tactiques: contusions; traitées en ambulatoire par des chirurgiens ou des traumatologues; en cas d'hématomes, une hospitalisation est conseillée.
Saignement intracavitaire
On entend par hémorragie intracavitaire une hémorragie dans les cavités séreuses. L'hémorragie: dans la cavité crânienne est définie comme un hématome intracrânien; dans la cavité pleurale comme un hémothorax; dans la cavité péricardique comme un hémopéricarde; dans la cavité péritonéale comme un hémopéritoine; dans la cavité articulaire comme une hémarthrose. L'hémorragie dans la cavité n'est pas seulement un syndrome compliquant l'évolution du processus pathologique sous-jacent, le plus souvent un traumatisme, mais aussi la principale manifestation évidente d'une lésion ou d'une rupture de l'organe parenchymateux.
Les hématomes intracrâniens se forment principalement à la suite d'un traumatisme cranio-cérébral, plus rarement à la suite d'une rupture d'anévrisme vasculaire (plus souvent chez les garçons de 12 à 14 ans lors d'un effort physique). Ils s'accompagnent d'un tableau clinique assez prononcé, mais nécessitent un diagnostic différentiel avec les contusions cérébrales graves et les hématomes intracrâniens, bien qu'ils soient souvent associés à une méningite.
Un hémothorax peut survenir en cas de lésion thoracique fermée avec atteinte du poumon ou de l'artère intercostale, de plaies thoraciques pénétrantes et de lésions thoraco-abdominales, ou encore de rupture de bulles pulmonaires vascularisées dans le cadre d'un emphysème bulleux. Dans ces cas, l'hémothorax est également une manifestation de lésion. À l'état pur (accumulation de sang uniquement), l'hémothorax ne survient qu'en cas de lésion isolée des vaisseaux intercostaux. Dans tous les cas de lésion pulmonaire, la formation d'un hémopneumothorax témoigne d'une altération de son étanchéité: parallèlement à l'accumulation de sang, le poumon s'affaisse et de l'air s'accumule dans la cavité pleurale. Cliniquement, il s'accompagne de syndromes anémiques, hypoxiques, hypovolémiques et pleuraux. Pour confirmer le diagnostic, il est nécessaire de réaliser une radiographie pulmonaire, une ponction de la cavité pleurale et, si nécessaire et si possible, une thoracoscopie. Le diagnostic différentiel est réalisé en cas de pleurésie, de chylothorax, d'hémopleurésie, principalement sur la base des données de ponction et de l'examen en laboratoire de la ponction.
L'hémopéricarde se développe lors de lésions thoraciques fermées et pénétrantes, lorsque l'agent pathogène atteint les parties antérieures du thorax. Le péricarde ne contient que 700 ml de sang; la perte sanguine n'entraîne pas de syndrome d'anémie aiguë, mais l'hémopéricarde est dangereux en raison d'une tamponnade cardiaque.
Le tableau clinique est caractéristique et s'accompagne d'une évolution rapide de l'insuffisance cardiaque: dépression; diminution progressive (minute par minute) de la pression artérielle; augmentation de la tachycardie avec diminution marquée du remplissage, puis transition vers une tachycardie filiforme, jusqu'à disparition complète. Parallèlement, la cyanose générale, l'acrocyanose et la cyanose des lèvres et de la langue augmentent rapidement. Concernant le diagnostic différentiel, il est important de rappeler qu'une telle évolution progressive de l'insuffisance cardiaque ne se produit dans aucune pathologie cardiaque, même en cas d'infarctus du myocarde; l'arrêt cardiaque survient soit immédiatement, soit sa progression est lente. La percussion, difficile à réaliser dans les situations extrêmes, révèle une dilatation des limites du cœur et du faisceau cardiovasculaire. Auscultation: sur fond de bruits cardiaques fortement affaiblis dans les premières minutes, on peut entendre un bruit d'éclaboussure; par la suite, des sons extrêmement étouffés sont notés, et plus souvent un symptôme de « flutter ». Il est nécessaire de différencier la maladie d'une péricardite. Dans tous les cas, le complexe doit commencer par une ponction péricardique, un ECG, et après déchargement du péricarde, réaliser une radiographie et d'autres études;
L'hémopéritoine se développe en cas de traumatisme abdominal fermé et pénétrant, de perforation d'organes creux, d'apoplexie ovarienne et de grossesse extra-utérine avec rupture des trompes de Fallope. Sachant que la cavité péritonéale contient jusqu'à 10 litres de liquide, l'hémopéritoine s'accompagne du développement d'un syndrome d'anémie aiguë.
En cas de lésions de l'estomac, du foie ou des intestins, dont le contenu est un puissant irritant pour le péritoine, le tableau clinique de péritonite apparaît immédiatement. En cas d'hémopéritoine pur, le tableau est atténué, car le sang n'irrite pas fortement le péritoine. Le patient est gêné par des douleurs abdominales modérées, qui s'atténuent en position assise (symptôme du « retournement de culbute »), car le sang afflue du plexus solaire vers le petit bassin et l'irritation disparaît; une faiblesse et des vertiges sont dus à une perte de sang; des ballonnements sont dus à l'absence de péristaltisme. À l'examen: le patient est pâle, souvent avec une teinte cendrée sur le visage; léthargique et indifférent, en raison du développement d'un choc hémorragique; à la palpation, l'abdomen est mou, modérément douloureux, aucun symptôme d'irritation péritonéale n'est exprimé. percussion, uniquement avec de grands volumes d'hémopéritoine - matité des flancs, dans d'autres cas - tympanite, due à une distension intestinale.
L'hémarthrose est une hémorragie articulaire qui se développe principalement à la suite de blessures. Les articulations du genou, qui supportent une charge physique maximale et présentent une vascularisation accrue, sont les plus souvent touchées. Les autres articulations sont rarement responsables d'une hémarthrose et présentent un tableau clinique moins marqué.
Les hémorragies intra-organiques sont des épanchements sanguins dans les cavités des organes creux. Elles arrivent en deuxième position après les hémorragies externes. Elles sont toutes dangereuses, non seulement en raison de l'importance de la perte sanguine, mais aussi du dysfonctionnement des organes internes. Elles sont difficiles à diagnostiquer, à prodiguer les premiers soins et à choisir une méthode de traitement pour la pathologie sous-jacente à l'origine du saignement.
Hémorragie pulmonaire
Les causes d'hémorragie pulmonaire sont variées: bronchite atrophique, tuberculose, abcès et gangrène des poumons, polypes bronchiques, malformations, tumeurs pulmonaires, pneumonie infarctus, etc. Ce type d'hémorragie est classé comme le plus dangereux, non pas à cause de la perte de sang, mais parce qu'il provoque le développement d'une insuffisance respiratoire aiguë, car il provoque soit une hémoaspiration (inhalation de sang dans les alvéoles avec leur blocage), soit une atélectasie du poumon, lorsque celui-ci est complètement rempli de sang.
Lors de la toux, du sang est libéré: mousseux, de couleur écarlate (en cas de tumeurs alvéolaires et de pneumonie infarctus - rose).
Le patient peut avaler ce sang et développer des vomissements réflexes sous forme de marc de café. Les expectorations doivent être recueillies dans des flacons gradués. La quantité permet d'évaluer l'intensité du saignement et est également envoyée en laboratoire. Lorsque jusqu'à 200 ml de sang sont libérés par jour, on parle d'hémoptysie; jusqu'à 500 ml de sang sont libérés par jour, on parle de saignement intense; au-delà, de saignement abondant.
Le diagnostic est confirmé non seulement par le tableau clinique: hémoptysie, syndrome d’insuffisance respiratoire aiguë, cacophonie à l’auscultation pulmonaire. L’hémoaspiration se manifeste également radiologiquement par de multiples petits assombrissements pulmonaires en forme de « tempête de neige », une atélectasie (assombrissement homogène du poumon – de l’ensemble des lobes ou des lobes inférieurs), avec un déplacement du médiastin: du côté de l’assombrissement (en cas d’assombrissement dû à un épanchement pleural, le médiastin se déplace du côté opposé); en cas de pneumonie infarctus, un assombrissement triangulaire du poumon, de l’apex à la racine. Une bronchoscopie à l’aide d’un endoscope tubulaire est absolument indiquée.
Un tel patient doit être hospitalisé: s'il existe une indication d'un processus tuberculeux - dans le service de chirurgie du dispensaire antituberculeux; en l'absence de tuberculose - dans le service de chirurgie thoracique; en cas de tumeurs des poumons et des bronches - dans les dispensaires d'oncologie ou le service thoracique.
Saignements gastro-intestinaux
Ils se développent avec des ulcères de l'estomac et du duodénum, des colites, des tumeurs, des fissures de la muqueuse (syndrome de Mallory-Weiss), une gastrite atrophique et érosive (surtout après avoir bu des boissons de substitution).
Pour le diagnostic et la détermination de l'intensité de ce type de saignement, deux symptômes principaux sont importants: les vomissements et les modifications des selles. En cas de saignement faible: vomissements sous forme de marc de café, selles formées, noires; couleur. En cas de saignement important: vomissements sous forme de caillots sanguins; selles liquides, noires (méléna). En cas de saignement abondant: vomissements de sang non coagulé; selles ou absence de selles, ou mucus sous forme de gelée de framboise. Même en cas de suspicion, une FGDS en urgence est indiquée. La radiographie de l'estomac n'est pas réalisée en phase aiguë.
Les saignements œsophagiens surviennent à partir de varices œsophagiennes en cas d'hypertension portale due à une insuffisance hépatique, notamment en cas de cirrhose, d'hépatite ou de tumeur hépatique. Le tableau clinique du saignement évoque celui d'une hémorragie gastro-intestinale. Cependant, l'apparence du patient est typique d'une insuffisance hépatique: la peau est jaunâtre, souvent ictérique, le visage est bouffi, un réseau capillaire est présent sur les pommettes, le nez est bleuâtre, dilaté et des veines tortueuses sont visibles sur la poitrine et le tronc; l'abdomen peut être augmenté de volume en raison d'une ascite; le foie est souvent fortement augmenté de volume, dense, douloureux à la palpation, mais peut également être atrophique. Dans tous les cas, ces patients présentent une insuffisance ventriculaire droite avec hypertension pulmonaire: essoufflement, instabilité pressionnelle, arythmie, pouvant aller jusqu'au développement d'un œdème pulmonaire. Une FGDS en urgence est indiquée pour le diagnostic et le diagnostic différentiel.
Les saignements intestinaux, provenant du rectum et du côlon, peuvent être causés le plus souvent par des hémorroïdes et des fissures anales; plus rarement par des polypes et des tumeurs du rectum et du côlon; et encore moins souvent par une rectocolite hémorragique non spécifique (RCH). Les saignements du côlon supérieur s'accompagnent de selles liquides et sanglantes sous forme de caillots sanguins ou de méléna. Les saignements rectaux sont associés à des selles dures, tandis que les saignements dus à des tumeurs ou des polypes débutent avant les selles, tandis que les saignements dus aux hémorroïdes et aux fissures anales surviennent après les selles. Ces saignements sont veineux, peu abondants et s'arrêtent facilement d'eux-mêmes.
Pour le diagnostic différentiel, on réalise un examen externe de l'anneau anal, un toucher rectal, un examen du rectum au miroir rectal, une rectoscopie et une coloscopie. L'utilisation complexe de ces méthodes d'examen permet un diagnostic topique précis. Les méthodes radiographiques sont utilisées. L'irrigoscopie n'est utilisée qu'en cas de suspicion de cancer. En cas de saignement du côlon et du côlon sigmoïde, la coloscopie est la plus efficace, car elle permet non seulement d'examiner attentivement la muqueuse, mais aussi de coaguler le vaisseau hémorragique (électrorésection du polype hémorragique).
Saignement postopératoire
En règle générale, elles sont secondaires précoces. Le saignement des plaies postopératoires survient lorsqu'un thrombus est expulsé des vaisseaux de la plaie. Les mesures commencent par l'application d'une poche de glace sur la plaie. Si le saignement persiste, les bords de la plaie sont écartés et une hémostase est réalisée: ligature du vaisseau, suture du vaisseau avec des tissus, diathermocoagulation.
Pour contrôler le risque d'hémorragie intra-abdominale, des drains tubulaires sont insérés dans les cavités abdominale et pleurale après l'intervention. Ils sont reliés à différents types d'aspirateurs à vide: directement reliés aux drains (« poires ») ou via des bocaux de Bobrov. Normalement, jusqu'à 100 ml de sang sont évacués par les drains au cours des deux premiers jours. En cas d'hémorragie, un écoulement sanguin abondant se produit par les drains. Cela peut avoir deux causes.
Saignement afibrinogène
Elles se développent en cas de pertes sanguines importantes de fibrinogène sanguin, survenant lors d'interventions chirurgicales longues (plus de deux heures) sur les organes abdominaux et thoraciques, et d'hémorragies massives avec apparition d'une CIVD. Ces hémorragies se caractérisent par leur apparition précoce après l'intervention (presque immédiate, même si le chirurgien est sûr de l'hémostase); leur évolution est lente et ne répond pas aux traitements hémostatiques. La confirmation est obtenue par un test de fibrinogène sanguin. Le fibrinogène sanguin peut être restauré et, par conséquent, le saignement peut être arrêté par transfusion de fibrinogène de donneur (mais celui-ci est très rare). Cela peut se faire en réinjectant son propre sang dans les cavités. Le sang est recueilli dans un flacon Bobrov stérile sans conservateur, filtré puis réinjecté. Le fibrinogène sanguin se reconstitue spontanément en 2 à 3 jours.
Un saignement secondaire précoce évident se développe lorsque la ligature glisse du vaisseau en raison d'un défaut de mise en place. Il se caractérise par un afflux sanguin soudain et massif dans les drains, entraînant une forte détérioration de l'état du patient. Pour stopper ce saignement, malgré la gravité de l'état du patient, une nouvelle intervention chirurgicale est réalisée en urgence (réparatotomie ou réthoracotomie).
Comment examiner?
Traitement hémorragies
On distingue l'arrêt spontané et l'arrêt artificiel du saignement. L'arrêt spontané survient lorsque les vaisseaux de petit calibre sont endommagés par un spasme ou une thrombose. Les lésions des vaisseaux de plus gros calibre nécessitent le recours à des mesures thérapeutiques; dans ces cas, l'arrêt du saignement est temporaire ou définitif.
L'arrêt temporaire du saignement ne justifie pas toujours son nom, car les mesures prises en cas de lésion des vaisseaux de taille moyenne, notamment veineux, permettent souvent un arrêt définitif. Les mesures d'arrêt temporaire du saignement comprennent la position surélevée du membre, le port d'un bandage compressif, la flexion maximale de l'articulation, la pression des doigts sur le vaisseau, la pose d'un garrot, la pose d'une pince sur le vaisseau et son maintien dans la plaie.
La procédure la plus courante en physiothérapie pour arrêter les saignements est l’application de froid.
Cette action consiste à appliquer une compresse sur la zone affectée (un sac contenant de la glace) afin de rétrécir les vaisseaux sanguins de la peau et des organes internes. Les processus suivants se produisent alors:
- Les vaisseaux sanguins de la peau se rétrécissent par réflexe, ce qui entraîne une diminution de sa température, la peau pâlit, le transfert de chaleur diminue et le sang est redistribué vers les organes internes.
- Les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent par réflexe: la peau devient rose-rouge et chaude au toucher.
- Les capillaires et les veinules se dilatent, les artérioles se rétrécissent; le débit sanguin diminue; la peau devient rouge et froide. Ensuite, les vaisseaux se rétrécissent, ce qui entraîne une diminution locale des saignements, un ralentissement du métabolisme et une diminution de la consommation d'oxygène.
Les objectifs de la procédure à froid:
- Réduit l'inflammation.
- Réduire (limiter) le gonflement traumatique.
- Arrêter (ou ralentir) le saignement.
- Anesthésier la zone affectée.
Le bandage compressif est appliqué comme suit: le membre blessé est surélevé. Un rouleau de gaze de coton stérile est appliqué sur la plaie et bandé fermement. Le membre est maintenu en position surélevée. La combinaison de ces deux techniques permet d'arrêter efficacement le saignement veineux.
Si les vaisseaux sanguins sont endommagés au niveau du coude ou du creux poplité, le saignement peut être temporairement arrêté par une flexion maximale de l'articulation, en fixant cette position avec un bandage en tissus mous.
Si les artères principales sont endommagées, le saignement peut être arrêté brièvement en appuyant le vaisseau contre les os sous-jacents avec les doigts. Ce type de contrôle du saignement (en raison de la fatigue rapide des mains de la personne portant assistance) ne dure que quelques minutes; un garrot doit donc être posé dès que possible.
Les règles d'application d'un garrot sont les suivantes: le membre blessé est soulevé et enveloppé au-dessus de la plaie dans une serviette, sur laquelle est appliqué le garrot. Ce dernier peut être standard (garrot en caoutchouc d'Esmarch) ou improvisé (morceau de tuyau en caoutchouc fin, ceinture, corde, etc.). Si le garrot est en caoutchouc, il doit être fortement tendu avant l'application. Une fois correctement appliqué, le pouls dans la partie distale du membre disparaît. Sachant que la durée de pose du garrot sur le membre ne dépasse pas deux heures, il est nécessaire de noter l'heure de son application, de la noter sur papier et de la fixer au garrot. Le patient doit être transporté vers un établissement médical accompagné d'un professionnel de santé. L'arrêt définitif du saignement peut être obtenu de différentes manières: mécanique, thermique, chimique et biologique.
Les méthodes mécaniques d'arrêt définitif du saignement comprennent le tamponnement, la ligature du vaisseau dans la plaie ou sur toute sa longueur, et la suture vasculaire. L'hémostase avec un tampon de gaze est utilisée en cas de saignement capillaire et parenchymateux, lorsqu'il est impossible d'utiliser d'autres méthodes. Après thrombose vasculaire (après 48 heures), il est conseillé de retirer le tampon pour éviter toute infection. La ligature du vaisseau dans la plaie doit être réalisée sous contrôle de la vue. Le vaisseau saignant est saisi avec une pince hémostatique, ligaturé à la base par un nœud, puis la pince est retirée et un second nœud est réalisé. Parfois, la source du saignement est masquée par une masse musculaire puissante, par exemple dans la région fessière; sa recherche peut entraîner un traumatisme supplémentaire important. Dans ce cas, le vaisseau est ligaturé sur toute sa longueur (artère iliaque interne). Des interventions similaires sont réalisées en cas de saignement secondaire tardif d'une plaie purulente. Une suture vasculaire est appliquée lors de la suture des extrémités d'un vaisseau sectionné ou lorsque sa partie écrasée est remplacée par un transplant ou une endoprothèse. Les sutures manuelles sont utilisées avec des fils de soie ou sont réalisées à l'aide de dispositifs spéciaux qui fixent les extrémités du vaisseau déchiré avec des clips en tantale.
Les méthodes thermiques incluent l'exposition des vaisseaux hémorragiques à des températures basses et élevées. Le plus souvent, pour prévenir la formation d'hématomes intermusculaires et d'hémarthroses, on utilise une exposition cutanée au froid sous forme de compresses de glace, d'irrigation au chlorure d'éthyle, de compresses froides, etc. Les saignements capillaires et parenchymateux sont efficacement stoppés par des compresses imbibées d'une solution chaude de chlorure de sodium à 0,9 %. L'électrocoagulation par diathermie assure une bonne hémostase des saignements des vaisseaux de petit et moyen calibre.
Les méthodes chimiques d'arrêt des saignements comprennent l'utilisation de vasoconstricteurs et d'agents coagulants, administrés localement et par voie intraveineuse. Les plus courantes sont les lotions et les lavages de plaies avec des solutions de peroxyde d'hydrogène, une solution d'épinéphrine à 0,1 %, et des chlorures de calcium et de sodium. Des solutions de chlorure de calcium à 10 %, d'acide ascorbique à 5 %, d'acide aminocaproïque à 4 %, etc., sont administrées par voie intraveineuse.
Les méthodes biologiques d'arrêt des saignements sont principalement utilisées pour les saignements capillaires et parenchymateux. Ces saignements sont dus à des interventions chirurgicales associées à la séparation d'importants conglomérats adhésifs et à des lésions des organes parenchymateux (foie, reins). Toutes les méthodes biologiques d'arrêt des saignements peuvent être classées selon les groupes suivants:
- tamponnement d'une plaie hémorragique avec des tissus autologues riches en thrombokinase (épiploon, muscle, tissu adipeux, fascia); le tamponnement est réalisé avec un morceau libre d'épiploon, de muscle ou une greffe pédiculaire avec suture des bords des plaies;
- transfusion de petites doses (100-200 ml) de masse de globules rouges, de plasma;
- introduction de bisulfite de sodium de ménadione et d'une solution à 5 % d'acide ascorbique;
- application locale de dérivés sanguins (film de fibrine, éponge hémostatique, etc.): ils sont introduits dans la plaie et y sont laissés après sa suture.
En cas d'anémie aiguë, il est nécessaire de déterminer le volume sanguin perdu. Il peut être déterminé approximativement de la manière suivante.
En fonction du tableau clinique.
- Il n'y a pas de troubles hémodynamiques - la quantité de perte de sang peut atteindre 10 % du volume sanguin circulant.
- Peau pâle, faiblesse, rythme cardiaque jusqu'à 100 par minute, pression artérielle diminuée à 100 mm Hg - perte de sang jusqu'à 20 % du volume sanguin circulant.
- Pâleur sévère de la peau, sueurs froides, adynamie, fréquence cardiaque jusqu'à 120 par minute, pression artérielle inférieure à 100 mm Hg, oligurie - perte de sang jusqu'à 30 % du volume sanguin circulant.
- Altération de la conscience, fréquence cardiaque jusqu'à 140 battements par minute, tension artérielle inférieure à un niveau critique, anurie - perte de sang supérieure à 30 % du volume sanguin circulant.
- En cas de fractures du tibia, le volume de perte de sang est généralement de 0,5 à 1 l, de la cuisse de 0,5 à 2,5 l, du bassin de 0,8 à 3 l.
La quantité de sang perdue ne peut être déterminée de manière fiable qu'à l'aide de tests de laboratoire (à l'aide de tableaux ou de nomogrammes prenant en compte la pression artérielle, le BCC, l'hématocrite, la gravité spécifique du sang, etc.)
Une perte sanguine aiguë doit être immédiatement compensée et si le taux d'hémoglobine est de 100 g/l et l'hématocrite de 30 %, une transfusion de produits sanguins est indiquée.

